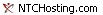| |
Avant, cétait la rue Saint-Ambroise.
Un studio très sombre dans un vieil immeuble du onzième arrondissement de Paris.
Avant, cétait les chiottes à la turque sur le palier, avec la porte de lappartement dont je ne devais pas oublier de prendre la clef pour ne pas me retrouver enfermé, en pyjama, dans lescalier.
Avant, cétait se laver dans un tube dans lespace minuscule de la cuisine, se frotter avec un gant puis se rincer avec une casserole deau sur la tête.
Avant, cétait cette cour intérieure lépreuse que je regardais en rêvassant au lieu de faire mes devoirs.
Avant, cétait triste, cétait sombre, cétait pauvre.
Après, cétait gai, lumineux et propre. La première salle de bain dans lappartement ! Une baignoire sabot, les WC, la lumière qui entrait partout.
Nous passions dun deux-pièces cuisine minuscule à un vrai appartement avec trois chambres et salle de séjour.
Une chambre pour ma mère, une pour moi tout seul et une pour la Mamichka, mon arrière grand-mère.
Un balcon sur de grands espaces lumineux, une cuisine où lon pouvait manger, des placards partout
Il y avait même dans cet appartement un séchoir, pour faire sécher le linge, une sorte de balcon fermé, où lon entreposait les légumes et tout ce qui ne rentrait pas ailleurs.
Avant, cétait encore une sorte daprès guerre, avec des vélos et des hommes en canadiennes marron à gros boutons.
Avant, cétait la peur de la guerre en Algérie pour toute la famille restée là-bas, la peur des attentats aveugles. La guerre, lOAS et le putsch des généraux.
Avant, cest Michel Debré appelant les Parisiens à se rendre sur les aéroports à pied ou en voiture, dès que les sirènes retentiront, pour convaincre les soldats engagés trompés de leur lourde erreur et repousser les putschistes.
Après, cest la Mamichka à la maison, mon arrière grand mère, qui avait vécu toute sa vie à Alger, tout juste débarquée de lavion à laéroport dOrly. Cétait la paix. Cest lamour entre ces deux femmes, ma mère et sa grand-mère, qui depuis des années sécrivaient dans langoisse et la peur.
En 1962 cest tout un quartier de Sarcelles envahi par les rapatriés. Il y avait un café en plein milieu qui sappelait lOASis et tout le monde savait pourquoi !
Dehors sur le parking qui séparait lallée Watteau de lallée Fragonard, les arbres qui venaient juste dêtres plantés, étaient tout petits et ne faisaient pas dombre. On y voyait parfois de drôles de gens montrant des ours et des singes.
La ville était déjà très grande. Elle avait bien dépassé les possibilités de la gare SNCF qui nétait quune halte sans bâtiment, surmontée dun pont, celui de Garges-les-Gonesse. Pourtant tous les matins et tous les soirs des milliers de Sarcellois montaient et descendaient le sinistre escalier de bois.
Les journalistes parisiens, bien logés dans les grands appartements du septième arrondissement de la capitale décrivaient avec mépris la Sarcellite comme une maladie honteuse. Pourtant cette ville brassait des gens de toutes origines et de tous les milieux sociaux, des provinciaux venus travailler à la capitale, des Parisiens chassés par les opérations immobilières et la hausse des loyers, des pieds noirs, des Juifs sépharades et les premiers immigrés maghrébins et africains.
La Maison de la Jeunesse et de la Culture et la bibliothèque de Sarcelles ouvraient pour une grande partie des jeunes un accès à la culture que Paris leur aurait refusé.
Le monde changeait en 1962 et Sarcelles en était la vitrine.
Et puis lannée 1962 sest terminée dans un grand hiver très froid. La chaufferie est tombée en panne. La Mamichka, déjà très âgée, ne sortait plus de lappartement. Elle est tombée malade et elle est morte en janvier 1963.
Depuis, cette ville est devenue autre chose et comme beaucoup dautres grands ensembles elle est synonyme de banlieue dangereuse.
Elle nen restera pas moins pour ceux qui ont vécu cette année 1962 comme une première marche vers le confort, la luminosité et
la modernité.
Marc BERNARD, 23 mars 2010
Les photos ont été prises par la mère de l'auteur, Madeleine SAFRA
|